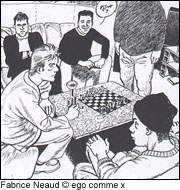
L’homophobie passive
par Hervé B.
L’homophobie existe-t-elle réellement sous une forme passive ?
Le Journal nous propose rapidement une réponse à cette question. Dès la 2ème planche du 1er volume (page 6), alors même que l’orientation sexuelle n’est pas définie (donc largement avant la puberté), des propos (innocents diront certains) mais clairement homophobes et sexistes sont prononcés : « Allez ! A poil, montre-nous que t’es pas une gonzesse !!» qui suivait un « ... le pauvre petit chéri s’est fait mal en tombant... » de la même facture. Même si c’était peu clairement exprimé, les références aux "tapettes" étaient évidentes (références que l’on retrouvera page 19 dans le mépris des hétéros pour les homos) alors même que les enfants ne conçoivent pas ce qu’ils disent. Imaginez donc l’effet à retardement que cela produit sur un jeune lorsqu’il réalise qu’il est une de ces "tapettes" que l’on méprise tant. Mais s'agit-il d'homophobie ou de la recherche de la différenciation entre garçon et fille (avec le rejet de la féminité chez les garçons) comme nous le montre l'ouvrage XY - De l'identité masculine d'Elisabeth Badinter ?
En partant de simples phrases qui révèlent notre "conditionnement" hétérosexiste (et que l'on soit homo ou hétéro) dès l’enfance, et en dehors de l’influence que les violences physiques homophobes (réelles ou potentielles) peuvent avoir sur le comportement en société de tout homo, on perçoit bien qu'il y a quelque chose de réel qui n'est pas clairement visible. Alors, qu’est donc l’homophobie passive ? Peut-on parler d'une violence qui ne soit pas physique ? N’est-elle pas la vue paranoïaque de quelques homos ? Et sous quelles formes s’exerce-t-elle ? C’est à ces questions qu’il va falloir s’efforcer de répondre ici.

L'hétérosexisme, une violence morale homophobe ?
Pour comprendre en quoi l'hétérosexisme est générateur d'une violence morale, symbolique, il est nécessaire de définir ce terme qui n'a pas d'existence officielle (de même que hérétocentrisme et hétéronormativité). Le Dictionnaire de l'homophobie propose de le définir ainsi : « Un principe de vision et de division du monde social (...) qui repose sur l'illusion téléologique » (c'est à dire constitutive de la finalité humaine) « selon laquelle l'homme serait fait pour la femme et surtout la femme pour l'homme, intime conviction qui se voudrait le modèle nécessaire et l'horizon ultime de toute société humaine ». Ainsi on attribue à l'hétérosexualité le caractère de seule sexualité "normale", légitime, ce qui a pour effet de justifier à priori et à posteriori toute discrimination et stigmatisation des personnes, homosexuelles mais aussi bisexuelles. Un positionnement par rapport à l'homophobie peut être fait (un peu comme pour la misogynie et le sexisme), l'hétérosexisme étant une inégalité des sexualités quand l'homophobie est un rejet (pour ne pas dire une haine) de l'homosexualité. Pour ceux qui souhaiteraient développer cette notion, je renvoie à la lecture de l'excellent texte de Georges-Louis TIN que l'on trouve à l'entrée Hétérosexisme.
L'hétérosexisme, un "principe de vision"
On pourrait dire que l’homosexualité est un révélateur, un élément de compréhension, une base de réflexion sur la façon dont nos sociétés sont socialement organisées pour permettre la mainmise du pouvoir par une certaine catégorie d’humains sur tous les autres. L’hétérosexisme, ainsi que le machisme et le culte du père sont des composantes du maintien de ce pouvoir. Le schème de pensée patriarcal institue un certain nombre de rôles bien définit aux hommes, aux femmes, aux enfants basés sur la sacro-sainte famille hétérosexuelle fondée dans le but de la conception d'une progéniture. Or, plus que le féminisme, l’homosexualité (la masculine mais aussi, et même peut-être surtout, la féminine) vient nous montrer que cette façon de penser est artificielle et aliénante pour toute une série de personnes. Et s’il l’est pour les homos, pourquoi ne le serait-il pas pour les hétéros, femmes ou même hommes qui n’ont pas envie d’avoir un comportement dont ils ne retirent aucun intérêt ou joie ? On peut avoir une conception du bonheur personnel qui ne consiste pas à épouser une personne de l’autre sexe pour avoir des enfants. Or tout comportement hors de cette norme est mal vu : les familles monoparentales, le refus d’avoir des enfants, le fait de préférer des personnes du même sexe sont autant de comportements qui étaient extrêmement mal vus il y a quelques temps chez nous et qui le reste dans nombre de sociétés ou de couches sociales de nos jours.
L'homophobie, un avatar du sexisme ?
Pour bien comprendre ce qu'est l'essence même de l'hétérosexisme, il est nécessaire de voir en quoi homophobie et sexisme sont liés. Tout d'abord, nos sociétés ont développé l'idée que l'appartenance à un sexe biologique correspondait à une appartenance à un genre social à qui il serait rattaché des rôles, des qualités et des défauts "naturels" et spécifiques. Pour simplifier, les hommes seraient évidemment forts (force physique étendue à tous les domaines) donc actifs, responsables, publics et les femmes, plus disciplinées, seraient les seules aptes à s'occuper des enfants et de l'espace domestique et privé. Inutile de dire que dans cette optique, les hommes sont supérieurs aux femmes. Comme je l'ai déjà dit, l'hétérosexisme est donc une construction qui s'articule autour de la cellule familiale composée d'un homme (le patriarche, le dirigeant), une femme (voire plusieurs) et des enfants et qui s'est imposée au fil du temps. Les différences individuelles s'en écartant ne sont donc pas tolérable : Une femme ne doit pas être à une autre place que la sienne, un homme ne peut pas vouloir vivre avec un autre homme. Le machisme (exemple de forme de sexisme) et l'homophobie se caractérisent alors comme une discrimination plus ou moins intériorisée (et donc souvent inconsciente, en tout cas, s'imposant à soi comme je le développerais dans la partie dédiée à l'homophobie intériorisée) envers les personnes qui brouillent les cartes en présentant des caractéristiques présupposées de l'autre genre (les symboles de la masculinité et de la féminité, vues comme des qualités et/ou des défauts : courage, autonomie, force, brutalité, douceur, compréhension, amour maternel, intuition féminine, faiblesse, ...) .
Une histoire de peurs
C'est cette construction que décrit Daniel Wezler-Lang dans l'ouvrage collectif La peur de l'autre en soi, du sexisme à l'homophobie : « Dans nos sociétés où les hommes, tant collectivement qu'individuellement, dominent les femmes, le sexisme organise la domination des femmes et l'homophobie vient sceller la cohésion entre dominants. Sexisme et homophobie nous disent : "tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque les différences sont naturelles" ». Les hommes ne doivent pas s'écarter de la virilité traditionnelle, dite naturelle, les femmes doivent rester à leur place pour s'occuper de la famille. La remise en cause de l'hétérosexisme, en entraînant obligatoirement une remise en cause de nombreuses normes sociales, une redéfinition des rapports humains et de l'abandon d'un ordre masculin concernera aussi bien les hommes que les femmes. En effet, si on parle de remise en cause de la masculinité, il faut aussi parler de remise en cause de la féminité. S'il est compréhensible que beaucoup d'hommes ne voient pas l'intérêt de remettre en cause leur position, il en va de même pour beaucoup de femmes. Il est confortable d'avoir une vie normée, guidée, où les rôles sont clairement définis, certains étant faussement valorisants. La définition actuelle de la féminité étant un produit du sexisme, sa remise en cause oblige à perdre ce confort, cette "sécurité". Il faudrait remettre en cause des certitudes comme celle qui veut que seules les femmes peuvent s'occuper des enfants grâce à leur (soi-disant) instinct maternel, alors que les hommes en sont tout autant capables : l'être humain n'est pas un animal, il s'agit d'un être pensant issu d'une sociabilisation complexe.
La "création" d'une violence morale
En simplifiant, on peut donc dire que cette norme de pensée, de vivre sa sexualité s'est établie au fil des siècles en Occident pour déboucher sur la notion de famille fondée autour du père et de la filiation, véritable socle social issu du XIXème siècle. A partir de là, une certaine violence symbolique va s'exercer à l'encontre de toutes les personnes (homos, hétéros célibataires, bi, trans, ...) qui refusent de s'y plier. Cette notion de violence morale est chère à Pierre Bourdieu qui la développe dans son essai La domination masculine. La violence symbolique se trouve dans des schèmes de pensée qui s'imposent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, principalement dans les relations de pouvoir. L'application de ces schémas de penser fait évidemment apparaître une supériorité de l'homme, du père, du chef... comme étant normale, naturelle, ce qui conduit souvent à une sorte d'auto- dépréciation, d'auto-dénigrement que les femmes se font de leur sexe et à l'adoption de comportements reproduisant (et de ce fait, confirmant) les représentations dont elles sont victimes (pages 53 et suivantes).
Quelques exemples
Cette violence symbolique hétérosexiste pour ne pas dire androsexiste, qui s'applique aux femmes, s'exerce aussi envers les homosexuel(le)s. Cela s'exprime par l'absence d'image positive dans les médias. Notons les édifiants exemples donnés dans le cinéma, ce que nous montre le documentaire The Celluloid Closet de Vito Russo ou la façon dont est souvent mis en avant une éventuelle homosexualité d'un tueur en série dans les journaux télévisés, pour ne pas parler de l'assimilation quasi-systématiquement faite de la pédophilie à l'homosexualité. Notons aussi l'existence, parmi les insultes les plus courantes, d'injures homophobes telles que "sale pédé", "va te faire enculer", "espèce de tapette". D'ailleurs, il n'est pas étonnant de constater que cette violence morale s'exerce surtout à l'encontre des hommes (encore un effet de l'androcentrisme, pillier de l'hétérosexisme). L'invisibilité des lesbiennes est une des violences qui s'exerce avec le plus de poids à leur encontre : elles n'existent pas, elles n'ont pas le droit d'exister (sauf sous la forme d'un des principaux fantasmes sexuels des hétéros, image peu reluisante s'il en est, et débouchant toujours sur une sexualité "normale", celle de l'homme).
Quand au Journal...
On retrouve cette violence symbolique dans le Journal(3) de Fabrice Neaud (pages 265 et suivantes) : L'hétérosexisme est tout puissant, « il n'y a aucun problème à assumer l'hétérosexualité, elle va de soi » et « la couleur hétérosexuelle n'a nul besoin de s'annoncer puisqu'elle est omniprésente, puisqu'elle est le préalable souverain »... Cette souveraineté va jusqu'à codifier la représentation des homos eux-mêmes et de leur amour : Quand on est un homme, « n'y a-t-il que deux façons d'aimer les hommes ? Être une pintade, et être un routier cuir-moustache ? ... en dehors de ces clichés plus rien n'est assez "pride" ? Enfin, par ces deux manières de codifier l'amour des hommes, glorifier la façon d'être hétérosexuel ? Une façon d'être en soustraction, négative, être "tout ce qui n'est pas, etc. "... » Tout est dit en quelques cases : l'hétérosexisme s'impose à tous et l'homosexualité est négation (c'est donc un "moins") car on N'est PAS hétérosexuel. Quoi de plus violent que de recevoir continuellement cette négation, ce "moins" dans la figure ?
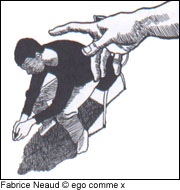
L'homophobie intériorisée.
Un des effets les plus pernicieux de l'hétérosexisme est de créer un sentiment honteux de leur orientation sexuelle chez les homos. C'est ce que l'on peut appeler l'homophobie intériorisée. Mais peut-on réellement parler d'homophobie envers soi-même ? Le terme n'est-il pas un peu trop fort, comparé à celui de "honte" d'être homo ?
Un conditionnement par la Société
Un certain nombre d'exemples donnés dans le texte précédent nous montre à quel point notre société renvoie une image négative de l'homosexualité, même si les choses commencent petit à petit à changer. Dès le plus jeune âge, la pensée hétérosexiste conditionne l'individu à tenir un rôle social précis dans un monde qui ignore les aspirations alternatives. Les garçons et filles apprennent à correspondre aux critères de masculinité et de féminité établis, leur place dans la société est définie à l'avance : "trouver l'âme soeur, s'installer, se marier, avoir des enfants", chacune de ces étapes étant normale, heureuse et publique. Sortir de ce schéma est alors quelque chose d'anormal, un malheur et doit être caché. L'âme soeur doit être une personne de l'autre sexe, il est anormal d'aimer quelqu'un du même sexe que soi. D'ailleurs la psychiatrie a longtemps considéré l'homosexualité comme une véritable maladie (le terme "inverti" faisait référence à la « personne atteinte d'inversion sexuelle », considéré comme une « anomalie psychique qui porte quelqu'un à n'éprouver d'affinité sexuelle que pour un être de son propre sexe », définitions tirées du Petit Robert, édition 1977, ce qui est à la fois révélateur de la façon de penser d'une société mais, aussi, ce qui alimente la façon de penser des membres de cette société) : il ne peut pas y avoir d'amour, seulement une déviance sexuelle. Etre anormal, car contre nature, est donc un malheur qui frappe la personne et surtout la famille qui est menacée de disparition, la descendance ne pouvant être assurée. Et, plus immédiat, l'honneur du nom (celui du patriarche) sera gravement compromis si cela venait à être su, l'affaire devant rester privée, les apparences sauvées. Evidemment, ceci s'applique surtout aux homosexuels, les lesbiennes sont dans une autre problèmatique, elles n'existent pas après tout. Une fille ne doit pas avoir de désir autre que celui de se sacrifier pour sa future famille : se marier afin d'apporter un support à son mari, avoir des enfants et les élever convenablement. Même si ces façons de penser ont beaucoup évolué sous l'influence du féminisme, permettant aux femmes de gagner une autonomie certaine, les principes fondamentaux sont toujours là : dès l'enfance, la fille est conditionnée à se sacrifier pour le bien de la communauté, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour une sexualité autonome et épanouie.
C'est une honte !
Il résulte des nombreux éléments exposés ici ou dans la partie précédente (aussi intéressant que cela soit, il est impossible d'énumérer ici les innombrables signaux qui participent à la création d'un sentiment d'infériorité chez les homosexuel(le)s) qu'il est difficile d'assumer la découverte de son homosexualité, de son acceptation et provoque une longue et douloureuse reconstruction de soi. L'image d'anormalité qui est donnée à l'homosexualité génère un sentiment fort de honte, honte qui crée "un sentiment de vulnérabilité", de "fragilité". Le Dictionnaire de l'homophobie, par le biais de son entrée Honte, nous explique que « la honte est un des mécanisme les plus puissants grâce auxquels l'ordre social nous "tient" et nous maintient sous son emprise, que ce soit en empéchant les "normaux" de s'éloigner du droit chemin, ou en poussant les "anormaux" à se cacher et à rester invisibles, à ne pas reconnaître leur appartenance à telle ou telle catégorie stigmatisée ». Comme le précise l'article, la grande puissance de cette honte est qu'elle est légitimée, acceptée dans nos sociétés hétérosexistes, y compris par les homos, au moins inconsciemment, s'imposant à leur comportement en société. Et c'est ce conditionnement qui s'impose à son "corps défendant", générant auto-dépréciation, auto-dénigration, donc un véritable sentiment d'infériorité (on retrouve le même mécanisme évoqué plus haut à propos des femmes hétéros ou non) qui est constitutif d'une véritable homophobie intériorisée.
Homophobie chez les homosexuels
Arrêtons-nous un instant sur la notion d'homophobie dans son application aux homosexuels. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aller lire la définition que propose le site. On s'aperçoit donc que l'homophobie a deux aspects, un social, culturel, collectif, lié à l'hétérosexisme et un autre plus personnel, plus psychologique, individuel. Les deux vont se mélanger et c'est donc au fin fond de soi que l'homophobie intériorisée va naître, bien plus puissante qu'une simple honte de soi. Même si elle n'est pas qu'un phénomène individuel, la honte de soi (après tout, ce phénomène n'est pas l'apanage exclusif des homos) est encore plus forte pour les homos, pouvant déboucher sur une réelle homophobie intériorisée. Cela peut se traduire par un rejet des homos alors qu'on est soi-même homosexuel ("je ne suis pas comme eux"), par une recherche d'isolement : quand on a honte, on se cache. Mais cette nécessité de se cacher peut aller plus loin car une fois que l'on a réalisé qu'on était pas "comme les autres", qu'on était "anormal" (il n'est pas naturel d'être homosexuel après tout, n'est-ce pas ?), ça peut aller jusqu'au désir de disparaître, de se supprimer. Et si on réussit à ne pas se suicider, il reste le fait d'être au ban de la société et de garder le désir d'être invisible. Cette invisibilité renforce l'image négative que l'on a de l'homosexualité en faisant disparaître les exemples d'homosexuels heureux (car oui, on peut être homo et être heureux), ce qui renforce l'homophobie et donc amplifie la honte d'être anormal. C'est un cercle vicieux qui ne peut être combattu qu'en réagissant contre cette honte : lutter contre l'homophobie est lutter contre la honte d'être homo, d'où l'importance de la construction d'une identité "gaie" par différents moyens et des gay prides. Il faut se réapproprier l'identité homosexuelle pour en faire un instrument de fierté afin de lutter contre l'homophobie intériorisée puis contre l'homophobie tout court. Mais certains estiment que cela peut générer des effets pervers envers ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'identité gaie telle qu'elle se construit actuellement ou qui ne peuvent « accéder à cette fierté ». On se retrouve alors avec des cas de double exclusion en créant un sentiment de « honte d'avoir honte ».
La haine de soi dans le Journal
Fabrice Neaud nous montre une voie médiane entre adhésion à la culture gaie permettant de s'affranchir de la honte d'être homo et invisibilité coupable qui renforce l'homophobie en soit et chez les autres. Si cette problématique de la "gaytitude" est développée dans une autre section du site, je rapellerais ces propos de l'auteur sur son Journal (lu sur le forum de BDParadisio) : « Je me souviens avoir mis dès le tome 1 du Journal un truc expliquant que la haine de soi naissait de ce moment où on se rendait compte que cette insulte nous définissait. "Tapette ils me traitaient et tapette je suis devenu", un truc dans le genre. On transforme cette haine de soi (provoquer par les autres, qu'on ne me dise pas le contraire, puisque justement, l'insulte précède dans la bouche d'autrui) en colère et en positionnement politique dans le meilleur des cas… ». Il est fait ici référence aux pages 18 à 23 qui nous illustrent la force de la honte en nous montrant un certain dégoût de n'avoir qu'une vie faite de peur (peur d'être reconnu, peur d'être agressé, peur de prendre des risques sentimentaux, ...). Déjà, il refuse cette façon de vivre, nous montre une volonté de lutter contre l'homophobie, qu'elle soit en lui ou chez les autres. Le Journal exprime souvent cette colère et devient un véritable instrument de lutte contre l'homophobie intériorisée en aidant à prendre conscience de celle-ci tout en manifestant une certaine réticence en développant un certain esprit critique envers la culture gaie et ses représentations, ses avatars (quelques exemples avec la page 41 du Journal (1), la page 63 du Journal (II), la page 105 du Journal (III) ainsi que la page 117 du Journal (4) nous montrent cette constant prise de recul de l'auteur face à une certaine représentation du monde gay qui s'imposerait à tous et à toutes).
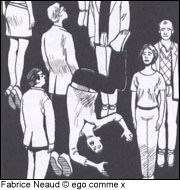
Le problème de la tolérance.
Tolérer les homos, c'est bien, c'est à la mode. Mais n'est-ce pas un nouvel avatar de l'homophobie passive ? Pour bien comprendre cette notion de tolérance, pour voir son contenu homophobe, il est nécessaire de bien préciser sa définition et son application envers les homosexuels. Si on ouvre notre dictionnaire, on peut lire dans le Petit Larousse (edition 1977) la définition suivante : « Disposition à admettre chez les autres des manières de penser, d'agir, des sentiments différents des nôtres ». Le tolérant étant "indulgent dans les relations sociales... ». Mais comme d'habitude, ce dictionnaire est trop limité et si on se tourne vers le Petit Robert (édition 1977), on commence à s'apercevoir d'une certaine dualité de la notion quand on l'applique à l'homosexualité : « 1° le fait de tolérer [laisser se produire ou substituer une chose qu'on aurait le droit ou la possibilité d'empêcher], de ne pas interdire ou exiger alors qu'on le pourrait ; liberté qui résulte de cette absention. 2° Attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même ». On voit donc qu'il y a deux notions qui ne se recoupent qu'imparfaitement et qui peuvent se mélanger dans la plupart des esprits. On est tolérant envers les homos parce qu'on autorise certains comportements (et donc intolérant lorsqu'on leur interdit de se marier ou d'adopter des enfants) ou parce qu'on admet qu'ils ne vivent pas leur sexualité comme "tout le monde" ?
Un petit exemple
Un exemple édifiant est donné par Fabrice Neaud (que l'on peut lire dans un sujet concernant son Journal sur le forum de BD Paradisio) : « anecdote fraîche de ce soir: je me fais précéder dans la rue par deux types qui se tiennent la main. Inutile de dire que dans ma campagne (qui n'est pas tout à fait le Yemen non plus), le fait est quasiment inédit. C'est aujourd'hui que ça se passe, hein, octobre 2004. Pas loupé. Les deux types croisent un groupe de jeunes apparemment inoffensifs. Comme je suis les deux types à vingt mètres, c'est moi qui entend les réflexions homophobes d'un des types du groupe. Pas loupé encore! "Putain, ch'uis tolérant, mais là, dans la rue, les deux pédés qui se tiennent la main… Est-ce qu'ils ont besoin de s'étaler comme ça?" Tel quel! Je vous le jure! Je n'invente rien!… Heureusement (et ceci ma profondément rassuré car je ne croyais guère à une réflexion "engagée" de la part des autres…), une des filles du groupe de lui dire aussitôt: "ben au contraire, ils ont raison de le montrer! Comment veux-tu que…" le reste s'est perdu car je les avais dépassé à mon tour. Mais on peut imaginer la suite : "comment veux-tu que ça avance s'ils se cachent?" ou un truc approchant. Il est évident que le débat a du être animé dans le groupe, après. Et c'est tant mieux ». Dans cet exemple, je vois l'application des 2 sens de la notion de tolérance s'appliquer : celle du type homophobe pour qui la tolérance est laisser se produire une action qu'il aurait la possibilité d'empêcher (par la prise à partie des 2 personnes) et celle de la fille qui admet chez les deux types le fait de se tenir par la main (il faut dire que la symbolique de se tenir par la main est beaucoup plus forte chez deux hommes que chez deux femmes où l'on pensera qu'il s'agit de deux bonnes copines et pas de lesbiennes).
L'Etat, la religion et l'intolérance
Le Dictionnaire de l'homophobie place la notion de tolérance sur un autre terrain, celui de l'intolérance telle qu'elle s'est révélée dans l'histoire ou lors des débats houleux lors de l'adoption du Pacs. On se place donc résolument dans le sens premier donné par le Petit Robert : on tolère car on n'interdit pas. Mais l'entrée donne une dimension supplémentaire en faisant intervenir la religion (dans le cas français, la chrétienté, ce qui nous amène à un troisième point qui n'a pas été encore abordé dans la définition : « 3° Hist. relig. (fin XVIème). Tolérance théologique, ecclesiastique, religieuse, indulgence à l'égard de l'opinion d'autrui sur les points de dogmesque l'Eglise ne considère pas comme essentiels »). Tolérance et religion sont intimement liées dans nos sociétés occidentales (mais dans de très nombreuses civilisations), le recul de la religion permet le développement de l'homosexualité publique et de sa tolérance. En effet, la religion catholique considère l'hétérosexualité pratiquée dans le but de procréation (concrétisée par le mariage et la famille) comme un point de dogme essentiel (pour approfondir ce point, voir la page consacrée à l'homophobie dans l'Histoire, plus particulièrement le développement de la notion de ce qui est "naturel" de ce qui ne l'est pas). La tolérance progresse aussi quand la discrimination recule. On est donc tout à fait dans la logique du premier sens de la définition donnée par le Petit Robert. En n'interdisant pas alors qu'il le peut, l'Etat, générateur de normes sociétales, produit une tolérance de droit mais cette dernière n'entraine pas une tolérance de fait. On peut donc dire que tolérance et homophobie sont liées par le fait que l'on tolère les gays à la condition de ne pas "aller trop loin" : « On veut bien accepter les homosexuels mais à la condition qu'ils ne s'affichent pas, qu'ils soient le plus discret possible, qu'ils soient ceci mais non cela ». On s'aperçoit donc que le second sens de la tolérance vu un peu plus haut est très limité au profit du premier, la tolérance étant « une pensée de la limite », de l'autorisation pour beaucoup de monde. Prôner la tolérance vis-àvis de l'homosexualité se heurtera donc à certaines limites (Dieu, la société, l'intérêt de l'enfant, ...) et on n'autorisera pas certains comportements et façons de penser ou de vivre. Mais il est malheureusement impossible de reprendre ici toute la richesse de l'entrée "Tolérance" du Dictionnaire de l'homophobie, je ne peux que vous inciter à la lire dans son intégralité.
La tolérance vue par Fabrice Neaud
C'est une perception différente de ce que nous avons vu jusqu'ici que Fabrice Neaud dénonce dans son Journal, particulièrement dans le volume 3 où toute une série de planches y sont consacrées, pages 266 à 268. La tolérance est une généralisation permettant la passivité : « En effet, nul ne songe à distinguer une bille blanche dans un sac de bille blanches (...) mais [le narrateur est] une bille noire. Bien sûr, les beaux esprits libéraux que nous sommes aiment à imaginer le sac rempli de billes de toutes les couleurs préférant la vérité des grands nombres, celle qui flatte la liberté individuelle. (...) Les beaux esprits libéraux (...) n'ont de "cool" que l'absence d'investissement ». Ne pas chercher à comprendre le cas particulier des homosexuels en s'en exonérant grâce à l'excuse de la tolérance, « c'est moins faire preuve d'un optimisme béat que de prendre une part activement à une irresponsabilité planifiée. La demi- teinte obligée de cette attitude est une modalité de leur non-agir, (...) plus n'est besoin de s'investir au-delà d'un consensus poussant à tout accepter de l'autre et ne permettant surtout de ne jamais prendre parti ni pour ni contre lui. Mais tout cela, toutes ces façons molles de réserver son jugement au point de ne plus rien faire d'autre, c'est le second visage même de la tolérance ». Elle devient, par son refus de réellement comprendre, de s'investir, d'agir, un acte homophobe. En effet « implicitement, il s'agit de ne pas faire de vagues. Mais quelle est la valeur de cette honorable neutralité quand à force de ne plus prendre parti ni pour ni contre l'autre on finit par surtout ne pas le secourir. La tolérance ? ou comment "buller" à la surface de l'intellectuellement-correct, avec la bénédiction de tout le corps social sans en foutre une ». Cela a pour conséquence de permettre aux à priori homophobes de continuer à subsister et à exercer leur oppression sous la forme de stéréotypes comme ceux du pédé, homme efféminé (la fameuse "folle" ou "tapette"), ou de la lesbienne "camionneuse" puisque de toute façon, on les tolère. Mais Fabrice Neaud va plus loin (pages 275 à 285) dans sa dénonciation de la tolérance, générateur d'actes homophobes. Etre tolérant envers les homosexuels est à la mode dans certains milieux, c'est "cool" mais cela se traduit par une invasion de ce monde, un vol de cette "culture" : « La tolérance ? C'est ce tourisme mental qui vous permet de visiter la condition d'autrui à moindre frais. (...) Elle vous permet de survoler un pays dont vous n'observerez jamais que la surface des moeurs (...) vous nous prenez tout ce qui vous arrange : un certain look, une certaine culture, une certaine révolte qui ne font qu'agrandir votre garde robe... ». Cela permet aux tolérants de pouvoir affirmer sans plus d'effort que « l'homosexualité n'est plus un motif de plainte » puisque les homos sont tolérés, pour ne pas dire assimilés. Mais ils ne se rendent pas compte (ne veulent pas se rendre compte) de la terrible réalité qui se cache derrière cette façade de tolérance que la gaytitude renvoie.
Tolérance et ignorance
Je terminerais cette partie concernant le Journal en montrant que l'auteur est tout à fait conscient des autres formes de la tolérance, de ses limites liées à l'ignorance. Il a eu l'occasion d'écrire (toujours sur le forum de BD Paradisio) : « Bien sûr qu'il vaut mieux tolérer par ignorance que haïr pour les mêmes raisons… (...) Mais j'émets l'hypothèse que les gens n'ignorent pas tant que cela les différentes sexualités que nous pouvons vivre. Quand je dis "n'ignorent pas", je veux dire que cela ne les empêche pas d'avoir une idée très précise sur la question tout en n'y connaissant rien… Ce que je veux dire, c'est que tous ces braves gens qui "ignorent" ou ne veulent pas savoir - peut-être avec le désir sincère, maintenus dans leur ignorance, de pouvoir exercer une tolérance assez saine ("moins j'en sais, mieux je me porte, et moins je peux juger. Donc moins je peux haïr, finalement") ». Mais dès qu'ils sont confrontés à une homosexualité qui ose sortir de la sphère privée, la réaction est souvent : « "Ah! c'est ça être gay? Mais pourquoi ils font ces carnavals ? Pourquoi ils s'affichent comme ça ? Bon, finalement, je les trouve plutôt antipathique avec leur prosélytisme." Sauf que, si ces mêmes braves gens savaient à quoi les gays sont confrontés tous les jours, s'ils savaient qu'il en va tous les jours de leur droit à l'existence, justement, ils comprendraient pourquoi on se fédèrent, même si nous sommes tous très différents dans nos façons de vivre la sexualité, aux moments de "nos" carnavals, par exemple » ?
La tolérance est homophobe
On en viendra donc à considérer que la tolérance actuelle consiste à dire "Oui aux homos" et à ne pas dire "les pédés au bucher" (c'est à dire dans le sens que l'on ne leur interdit pas de vivre leur homosexualité du moment qu’on ne les voit pas, avec les limites de la vie publique / privée) et "Bahhh des PD" quand on remarque deux hommes enlacés dans la rue ou lorsqu'ils réclament le droit de se marier et d'adopter et/ou d'élever des enfants au sein d'une famille homoparentale. Pour l’homosexualité féminine, c’est encore autre chose, les lesbiennes étant totalement invisibles tant qu’elles ne s’embrassent pas en public (et là, quel scandale), personne n'imaginant qu’elles soient autre chose que de bonnes copines en ballade (il est vrai que pour beaucoup, la sexualité féminine n'est pas une vraie sexualité). Or, une telle façon de penser EST de l’homophobie car elle est au mieux humiliante pour les homos, au pire, elle leur renvoie une image de rejet, de refus, d'interdits, de limites qui est extrêmement difficile à supporter. Il s'agit d'un niveau que l'on pourrait considérer comme bénin de l’homophobie qui est, certes, préférable à une société réprimant ouvertement, criminalisant, l’homosexualité mais la tolérance dont il est fait ici référence ne rend pas la vie des homos agréable pour autant, c'est le moins que l'on puisse dire. On peut difficilement le reprocher aux gens qui ont été ainsi socialisés (ce qui génère, comme on l'a vu auparavent, une honte d'être homo, pour ne pas parler d'homophobie intériorisée). Par contre, ce que l’on peut tout à fait reprocher aux "tolérants", c’est de refuser de réfléchir sur eux-même, de refuser de se remettre en question et de chercher à comprendre, de préférer la passivité et l'ignorance, d'utiliser leur prétendue tolérance pour se dédouaner de leur attitude. Surtout qu’une telle remise en cause de ce conditionnement social est tout à fait applicable au sexisme, au racisme, et permet de bien mieux appréhender son prochain et de mieux se comprendre par la même occasion. Cette compréhension est indispensable si on veut faire évoluer la société vers une véritable tolérance sans limite, définie comme étant celle « qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même ».